Le lac
Où Koma fait un break au lac.
KOMA
Nous avons de l’eau jusqu’à la taille.
Quelques heures plus tôt (ou quelques dizaines d’heures, je ne sais plus), nous nous étions barrées toutes les deux de la ville, des réunions, du stress, de la tristesse.
C’est là-bas que nous nous étions connues, dans une réunion du comité des mal-logé-e-s.
À chaque rencontre, je savourais ce sentiment naissant. C’était comme une complicité, pas tout à fait établie encore mais déjà puissante, comme une quête de liberté commune et très fluide, probablement trop intense pour évoluer longtemps entre les grillages serrés de la ville.
Alors, nous étions parties.
« On partirait ? Ai-je demandé la bouche collé au combiné, repoussant ma timidité avec une force inconnue de moi-même.
— Oui, on partirait, sans impératif et on arrêterait de compter le temps, comme dans les films et les romans !
— Je connais un lac pas très loin, on peut y aller en bus et en marchant encore un peu.
— Et quand peux-tu te libérer ma chère ?
— Quand ? Quand je veux. Quand tu veux en fait ! Je n’en peux plus d’ici. Je ne sais pas comment dire. J’étouffe.
Je n’avais rien dit à propos de la mort de Tor mais, bien sûr, ça ne me quittait plus.
— J’ai besoin de quitter quelque chose, ajoutais-je.
— Alors faisons ça, cassons-nous maintenant. On fait nos sacs, on passe prendre des trucs à tartiner dans n’importe quel magos sur le chemin, on laisse un mot à Mariana pour lui dire de ne pas s’inquiéter, qu’on va bien, et voilà : on est libre…
— Je prend de l’eau. Tu veux un sac de couchage, j’en ai un en rab’ ?
— Nan, c’est bon, j’en ai un aussi. Je te retrouve chez toi dans une demi-heure une heure !
— OK d’acc’ ! À tout de suite ! »
J’ai raccroché le téléphone et suis restée assise quelques minutes sur la vieille chaise en osier. Ma vie basculait encore : quelques phrases échangées au téléphone et un tourbillon euphorique s’emparait de moi. Mon boulot au lycée ? Je m’en foutais complètement… Je devais rester prudente. La mort de Tor me rendait vulnérable, c’était sûr. Je devais rester méthodique pour ne pas me mettre en danger. Mais justement, tout était tellement simple, j’avais besoin de couper, tout de suite, pour ne pas partir en vrille. L’évidence avec laquelle nous nous étions décidée, avec laquelle nous nous préparions, avec un minimum de mots, une chose après l’autre. Quelle bonne humeur ! Je me rappelais la maison collective et les heures de discussions pour prendre quelques pauvres décisions… Je prends le téléphone. Je me racle la gorge pour trouver un ton un peu rocailleux, je me pince un narine pour la sinusite, et je demande le secrétaire général :
— Monsieur Gardin ? Oui, c’est madeboiselle Biza, boui Suzie Biza. Écoutez, j’ai un ruhbe terrible, les sinus, les bronches, tout ! Boui ça doit être ça, le printemps, l’air qui radoucit… Je vous aborte un certificat à mon retour… boui… j’espère en bilieu de semaine, boui boui, merci Beusieur Gardin…
Et voilà, nous sommes parties, il y a quelques heures à peine. J’avais ce même genre de besoin que celui qui me poussait avant à me réfugier au fond du jardin au bord de la petite marre, pour échapper au collectif. Quand j’étais arrivée en ville, j’avais cru que la solitude serait facile, mais c’était dur et presque pire. Puis j’avais reconstitué le rythme infernal de ma vie, progressivement : quotidien-travail-mensonge-réunion-travail-peur-quotidien-travail-peur-réunion-discrétion-travail-action… Et puis la mort de Tor. Pas étonnant que ce besoin d’échappée remonte une nouvelle fois en moi.
Dès la première réunion, j’avais remarqué ses longs cheveux bleus, sa peau pâle et ses yeux noirs-brillants qui lui donnait l’air d’une extraterrestre. Pas du tout mon style de fille. Mais son image était captivante, éclairée par les ombres du feu, sous le pont froid du grand boulevard C. Degaulle. Très vite, nous avions passé tout le temps possible ensemble, le plus souvent seules. Nous parlions très peu de ça.
Le monde ne voulait pas de nous, encore heureux, car nous ne voulions pas de lui non plus. Quelle coïncidence !
Elle avait frappé à la porte, prête, son sac sur le dos, j’avais pris le mien, nous nous étions regardées longuement avant de nous serrer dans les bras. Je m’étais retournée et j’avais fermé la porte à clef. Nous partions pour toujours.
« Voilà ! Avais-je dit.
Après un long moment de silence, elle avait demandé :
— C’est comme si on partait pour toujours n’est-ce-pas ?
— Nous ne sommes pas obligée de décider combien de temps ça va durer…
— Mmmh ! Avait-elle réfléchi… ou bien parce qu’on s’en fout un peu, ou bien parce qu’on a envie de s’en foutre. Ou bien parce qu’on voudrait s’échapper de toute cette merde, ou bien parce qu’on sait qu’on n’y arrive pas vraiment…
— On y arrive très bien.
— Encore heureux qu’on va vers l’été. »
Nous étions déjà en train de marcher dans la rue. Je sentais mon regard confiant et déterminé, un regard qui m’étonnait de moi.
Quand nous avions atteint la forêt, je me sentais tourmentée, le ventre un peu bizarre, le cœur un peu trop haut.
« Tu sais, je crois que je voudrais te dire quelque chose…
Un silence.
— Vas-y, dis-moi.
— Je crois qu’avec toi, je me sens plus forte, presque invulnérable.
Elle n’avait rien dit.
— Je crois que ça me fait peur.
Je me suis tue.
— De quoi ? Je veux dire, qu’est-ce qui te fait peur exactement ?
— Ben nous, enfin toi, enfin moi… J’ai peur de ne plus pouvoir vivre sans toi. J’ai peur d’après, quand on va rentrer.
Nous avions continué de marcher en traînant nos pieds dans les vieilles feuilles mortes à moitié décomposées, à la recherche de ce bruit tellement agréable… Schrit schrit schrit à chaque pas. Mais nous étions en avril : les feuilles de l’automne précédant étaient bien ramollies sous nos pieds.
— Bon, j’ai peur mais pas tant que ça. On traverse des choses difficile alors pour une fois, foncer un peu… Me la jouer spont’ comme il y en a qui disent !
Et je lui avait fait un clin d’œil un peu aguicheur. À ce moment-là, précisément, j’avais pris conscience que je m’emballais carrément.
— Je… je… oui. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas.
— On pourrait faire ces promesses de ne jamais se quitter, d’être toujours ensemble. Mais ça ne sert à rien, les promesses ne tiennent jamais. Le temps va passer, les situations vont changer, nous même on va changer et rien ne sera plus jamais pareil.
— Il faudrait essayer de garder ce moment comme un bon souvenir qui fait du bien à la mémoire mais dont on attende pas qu’il se reproduise à nouveau.
J’avais tapé encore dans les feuilles luisantes.
— Sauf que ça ne marche jamais vraiment comme ça. Mais un truc qu’on pourrait faire… Peut-être qu’il faut seulement essayer de toujours se dire les choses, d’être franches.
— Oui, on peut se faire confiance pour ça. »
Nous avions dormi côte à côte dans une clairière, à quelques pas du lac, sous un ciel clair et étoilé. Nous avions eut d’interminables discussions sur les « stratégies politiques ».
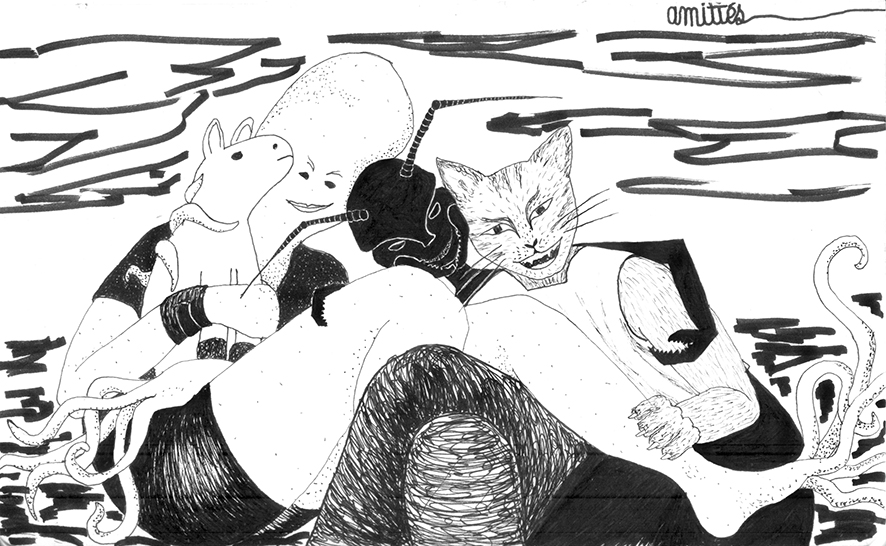
Il était encore tôt quand nous nous étions réveillées, l’eau limpide semblait nous appeler et nous nous étions dirigées vers le bord du lac.
Nous étions entrées dedans, c’était froid et l’eau nous pinçait la peau. Nous nous étions enfoncées en riant :
« Ouais j’en suis aux genoux !
— Hhaa ! Attend, c’est trop dur pour la chatte… hou, comme je déteste ça !
— Vas-y, en mouillant d’abord les bras et la nuque, c’est plus facile !
— Ah mais c’est trop froid…
— Ouah, je passe le nombril !
— Aller, la première qui plonge a gagné ! »
Nous plongeons, en ressortant le tête de l’eau, j’inspire une grande goulée d’air, tout le corps crispé par ce réveil.
« Haaa ! Ça fait trop du bien ! »
Nous nous regardons et une envie irrépressible me prend de me rapprocher d’elle, de coller ma peau contre la sienne, de l’enlacer, de la serrer contre moi. Nous nous fixons du regard et peu à peu je suis juste à côté, nous nous touchons des bras. Elle ne détourne pas les yeux et semble m’attendre. Je ne sais plus trop ce que je fais. Je suis complètement folle de faire ça, et j’ai peur de la route sur laquelle je m’engage. Mais tout son corps et tout son sourire me disent de venir et je pose mes lèvres sur les siennes. Nos lèvres sont mouillées d’eau, nos jambes battent dans les courant froids, se frôlent et se cognent lentement. Ma main sur son bras, je sent la chaleur de son corps qui brise la fraîcheur de l’eau. Sa peau est lisse, légèrement gluante. Encore un regard et cette fois, c’est elle qui m’embrasse. Les lèvres entrouvertes, sa langue vient tracer le contour de mes lèvres avant de glisser le long de mes dents pour jouer avec sa semblable. Nous nous enlaçons sans prendre la peine de continuer à nager et nous enfonçons quelques secondes dans l’eau. Respirations en surface et elle m’embrasse encore, furtivement cette fois-ci. À peine ses lèvres posées sur les miennes, elle recule et me souri, avant de partir tout en continuant de me regarder. Je plonge pour la rattraper, elle nage plus vite, j’essaye de la devancer, de l’attraper, avant de la fuir et que le jeu s’inverse. Nous rions de ce jeu amoureux et soudainement épuisées, nous regagnons la berge.
L’eau jusqu’à la taille, nues, nous regardons au loin.
Et là, le mec se pointe au-dessus de nous. Par réflexe elle s’accroupit dans l’eau et moi, je me cache les seins et le sexe avec les mains. Nous avions eut le temps d’oublier les autres, d’oublier que ce monde était aussi peuplé d’autres personnes qui, même-si elles ne nous intéressent pas, peuvent pourtant faire intrusion dans notre univers.
Et là cet autre, il semble légèrement plus gratiné que la moyenne : il s’est assis au bord de l’eau en lançant un truc du style : « C’est bon, ne vous gênez pas mesdemoiselles, continuez comme si je n’étais pas là, j’adore le paysage », tout ça avec un petit ricanement, en nous fixant de son regard dégueulasse.
Comment ose-t-il s’immiscer ainsi dans notre univers, l’air de rien, avec ses intentions salaces ? Pourquoi ai-je le réflexe de me cacher quand c’est à lui, briseur d’instant, de le faire ? Ma colère monte quand elle prend ma main tout en se dressant debout, son torse lui faisant face. Nos regards sont emplis de fierté, de colère et de détermination. Sans parole, les épaules larges, les points fermés et le regard droit, nous nous avançons, lentement dans sa direction, sans arrêter de le fixer.
Tout à coup, il a l’air beaucoup moins à l’aise et détourne le regard.
« Tu veux quoi ?
J’ai largement inspiré pour lancer cette question, en détachant les syllabes et en criant fort. Il ne répond pas, regarde des oiseaux imaginaires sur l’horizon.
— Hého ! On te parle, ne fait pas semblant d’être absent !
— Tu nous branches alors tu assumes, ok ? »
Il fait mine d’hésiter et finalement, il tourne sa tête vers nous. Son regard coule rapidement sur nos corps, n’arrive pas à se fixer. Après un court instant, il nous regarde dans les yeux l’une et l’autre et sourit. Nous nous sommes arrêtées à quelques mètres de lui, l’eau aux chevilles.
« Hé, les filles ! Faut pas vous énerver comme ça. Si vous faites ça, c’est bien pour qu’on vous regarde, non ?
— Mais il est vraiment trop con !
— Aller quoi, des beaux corps comme ça, c’est fait pour être admiré. Faut pas vous mettre en colère !
— Nos corps ne sont pas pour ta sale gueule, alors tu te casses ! ».
C’est fou l’assurance que peut avoir un type comme ça, il est capable de tout pour déguiser ses intentions pourries en galanterie ! Nous crions, nous nous énervons et lui, il garde le privilège du calme… Nous ne trouvons rien d’autre à faire que de recommencer à avancer vers lui.
« Hé mais calmez-vous, vous devriez être flattées, vous avez peur des hommes ou quoi ?!
— On t’a dit de te barrer, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ?
— Je ne vais pas vous toucher, je ne fais que regarder, je les aime bien moi les minettes comme vous !
— Nous on n’aime pas les vicieux comme toi !
Cette fois, j’ai vraiment hurlé et sans réfléchir je me baisse, je ramasse une pierre et nous avançons franchement vers lui. Il se relève tout en reculant et en trébuchant.
— Pauvre type, on a dit qu’on ne voulait pas voir ta sale gueule ! hurle-t-elle à son tour.
— Il te faut quoi ? je lève ma pierre au dessus de ma tête, il faut t’éclater la tronche à coup de pierres pour que tu piges ce qu’on te dit ?
Et des images de Baise-moi me traversent la tête, j’adore ce classique.
Il recule, hésitant à courir, ce qui signifierait prendre le risque de nous tourner le dos. Il lance des regards hagards, comme s’il espérait de l’aide mais il n’y avait personne. Nous nous mettons à courir sans penser aux branches et aux pierres sous nos pieds nus et en poussant des longs hurlements. Il fait demi-tour et se met à galoper comme un lapin.
« Tu sais, les lapins ne galopent pas. Il n’y a que les chevaux et le poneys, qui galopent.
— Mais si… De toutes façons, on fait ce qu’on veut avec les mots, non ?
Et elle hurle encore vers le type qui rapetisse au bout du chemin :
— Salopard de macho, tu crois que tout t’appartiens ? On va te couper la bite et te jeter à la flotte !
— Espèce de merde ambulante ! ».
Nous sommes au milieu de la forêt à hurler des insultes. Il se retourne une dernière fois, alors on recommence à courir vers lui et je lui balance ma pierre, elle a atterri tout près de lui et il repart au quart de tour. Nous le coursons en lui balançant tout ce qui nous passe sous la main et en criant. Ce crétin courre, la tête rentrée entre les épaules, les bras au dessus de la tête.
Nous éclatons de rire, pliées en deux, le souffle court, les nerfs a vif.
Lire l’inédit suivant
Revenir à l’inédit précédent
Revenir au sommaire des inédits


